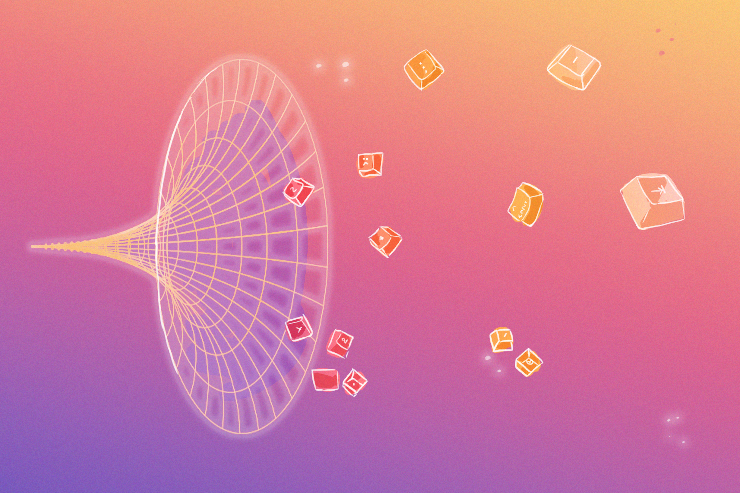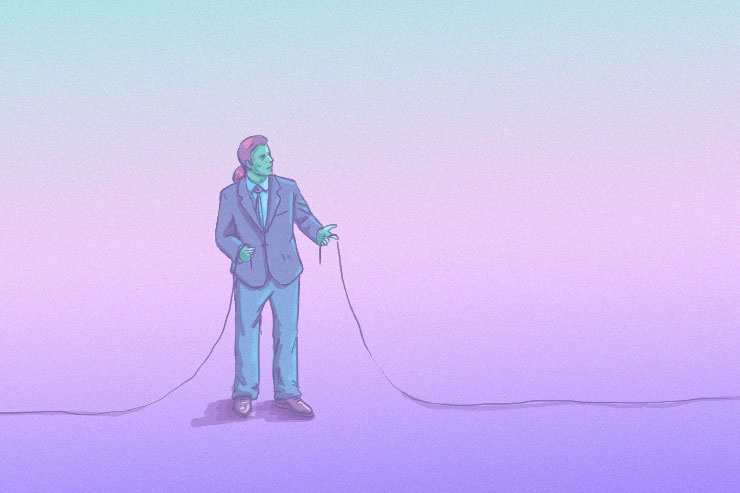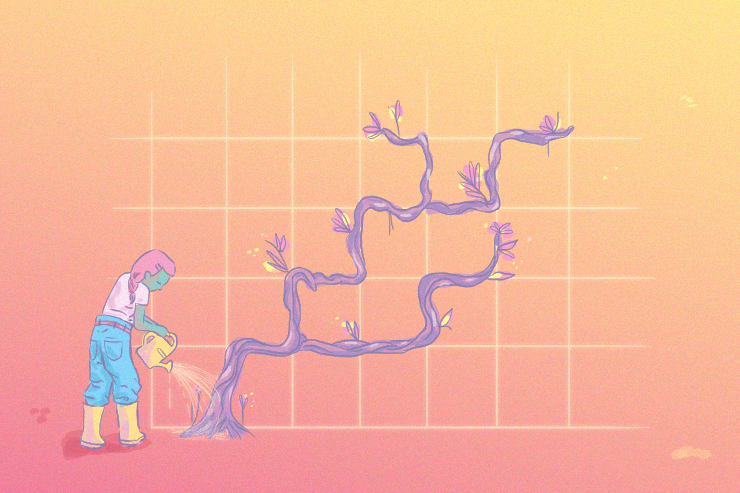X – Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette séance de formation au poste ?
Moi – C'est marrant que tu dises "au poste", de mon côté je n'ai pas vu autre chose qu'un tête-à-tête cordial et poli.
X – Je ne te savais pas aussi sévère. Il y avait quand même des standards écrits dans le classeur, une formatrice à côté du collaborateur et un échange fructueux dans le temps imparti. Ils l'ont écrit l'un et l'autre. Regarde le compte-rendu qu'ils ont produit...
Moi – Bien sûr qu'ils sont contents : l'un et l'autre ont vérifié qu'ils savaient lire une feuille A4 imprimé.
X – Mais non, tu ne peux pas dire ça : ils ont quand même manipulé le logiciel métier.
Moi – Ce n'est pas ce que j'ai observé : la formatrice lisait le début des phrases et le formé ânonnait la suite. Il n'a touché son clavier et sa souris qu'une seule fois pendant les 10 minutes passés ensemble.
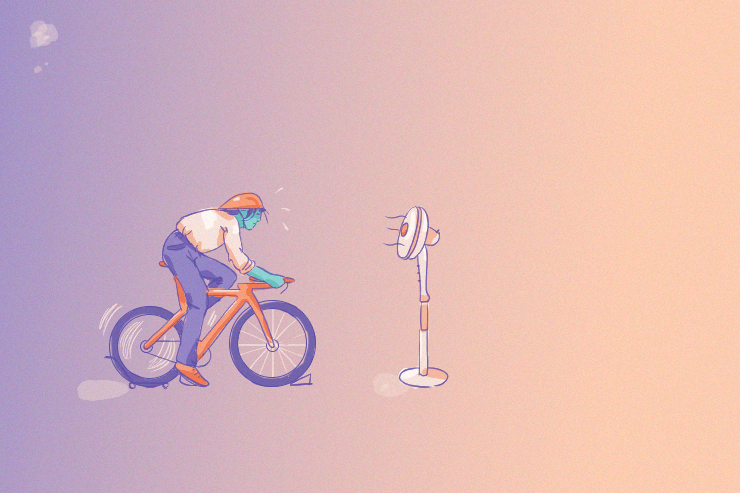
X – Pourtant le standard précise qu'ils peuvent utiliser la prochaine tâche à réaliser pour cette formation. Ne l'ont-ils pas fait ?
Moi – Et pourquoi l'auraient-ils fait ? Je suis certain que cette prochaine tâche est tout aussi simple ou répétitive que la précédente ou que celle qui viendra juste après. Et comme lui fait son boulot correctement (sinon il serait parti depuis plusieurs semaines) et qu'elle le sait, ils peuvent conjointement décider de faire autre chose à plus de valeur ajoutée pour un vrai client. Et c'est bien pour ça qu'on fait du Lean.
X – Attends, tu veux dire que former des gens, ce n'est pas Lean ?
Moi – Ne me fais pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement vu une formatrice s'assurer qu'un collaborateur savait faire son boulot.
X – Et que faudrait-il alors pour que tu puisses considérer que formation il y ait eu.
Moi – Plus d'expérimentation : les adultes, et ceux avec de l'expérience à fortiori, ont besoin de confronter ce qu'ils ont dans la tête avec une réalité.
X – Justement, c'est bien la réalité qu'ils avaient devant les yeux.
Moi – C'est pour cela que j'évoquai "une" réalité. Si je te montre la même tâche qu'hier ou que la semaine dernière, tu peux rester avec ton système 1, ton pilote automatique. Mais si je te propose un cas légèrement différent, parce que cette tâche arrive moins bien calibrée (elle a été préparée par un intérimaire), en retard (elle a été forwardée par email une veille de jour férié) ou par un canal inhabituel (c'est la fille d'un boss qui est concernée), comment vas-tu réagir ? Tu n'auras pas d'autre choix que d'activer ton système 2, que de réfléchir pour de vrai.
X – Mais c'est impossible que des cas tordus arrivent exactement avant la formation au poste. Et je ne peux pas créer de faux cas juste avant la formation dans notre base de données... Ce sera encore plus la pagaille derrière.
Moi – Dans mon univers, celui de la création de logiciels, chaque développeur va créer un test unitaire pour montrer qu'il a bien éradiqué le bug qu'on lui remonte. Ce test sera ensuite lancé automatiquement plusieurs fois par jour, mais bien sûr jamais sur la prod : on parle bien d'une environnement de recette.
X – Je crois que je commence à comprendre : tu penses qu'on pourrait avoir une copie de notre logiciel métier pour explorer tous ces cas tordus, accessible uniquement pour la formation au poste.
Moi – Je sais surtout que ton informaticien maison vient déjà sur votre gemba toutes les semaines : cela veut dire que vous avez déjà parcouru plus de la moitié du chemin vers votre dojo !