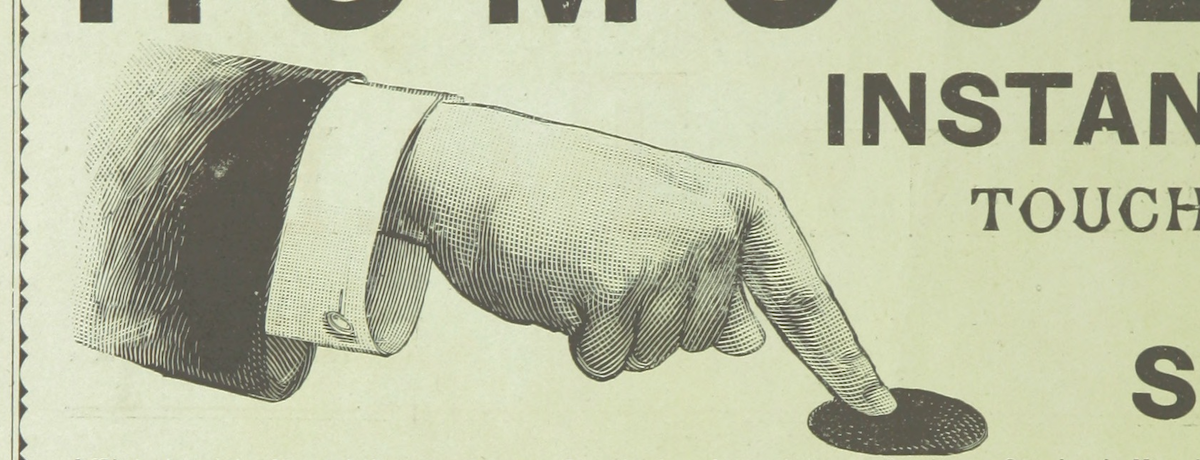Si la promesse de la fin de réunions absurdes sur Zoom commence à poindre le bout de son nez, d'autres pratiques inhibitrices d'intelligence existent au travail : la philosophe Peggy Avez nous invite à en explorer quelques unes. À méditer avant de reprendre le chemin du bureau...
Si l'on cherche à améliorer la vitalité d'une structure collective quelle qu'elle soit, on a intérêt à se poser une question radicale : comment cesser de gâcher l'intelligence des personnes impliquées ? Chacun·e a pu en faire l'expérience : lorsque vous sentez votre intelligence brimée, sous-évaluée, méprisée, vous souffrez et cherchez à vous retirer. Au niveau international, on évoque la fuite des cerveaux. Mais à une moindre échelle, ce mécanisme s'observe de bien des façons. Quelles sont ces pratiques ordinaires qui génèrent tant de souffrance chez les salarié·e·s et de pertes pour les organisations ?
Ce questionnement se heurte à de nombreux tabous. Mais ici comme ailleurs, oser penser l'impensé de nos pratiques sociales permet d'identifier des biais... et de nous en libérer peu à peu.

Voici, succinctement présentés, 5 inhibiteurs sociaux d'intelligence.
1. Le biais hiérarchique
Un préjugé qui structure nos perceptions (et nous aveugle !) veut que la supériorité d'un statut social indique la supériorité d'une parole. Dans un groupe donné, celui qui incarne l'idéal dominant par son diplôme, son genre, sa couleur de peau, son milieu social, a davantage raison que celui qui l'incarne moins.
Dans notre système de croyances, il faut ménager la susceptibilité de celui ou celle qui commande et se retenir de lui opposer des idées pertinentes. Ce n'est pas tant le désaccord qui pose problème, que la mise un mal d'un tabou social : il faut se comporter comme si le chef était plus intelligent que les personnes qui lui sont d'une façon ou d'une autre subordonnées. En d'autres termes, la dissymétrie socio-économique devrait nécessairement être soutenue par une dissymétrie intellectuelle, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Il faut donc jouer le jeu de ce fantasme.
Chacun·e va ainsi réprimer sa parole et son intelligence pour se conformer à l'ordre hiérarchique. La femme de ménage gardera pour elle une judicieuse observation, parce qu'elle sait par expérience qu'elle sera mal accueillie. Idem pour les stagiaires, comme les secrétaires et toutes les personnes prises dans des relations qui les considèrent comme des subalternes.
Dès l'enfance, nous apprenons à ne pas nous montrer plus intelligent·e·s que les personnes exerçant l'autorité. Le respect envers l'autorité doit se manifester par l'écrasement de sa propre intelligence. Parents et professeurs n'admettent pas que les jeunes puissent avoir des idées plus pertinentes que les leurs. Cette dissymétrie les encourage donc à répéter leurs convictions sans les penser plus loin. On apprend en famille et à l'école ce qu'il faudra rejouer dans la vie professionnelle : renoncer à exercer son intelligence parce qu'on incarne déjà soit l'autorité, soit le/la subalterne.
La hiérarchie n'est donc pas seulement un mode d'organisation abstraite des fonctions. Elle structure la façon dont nous nous comportons les un·e·s avec les autres. Cette « mise en scène de la vie ordinaire » pour reprendre le titre du sociologue américain Erving Goffman - qui a beaucoup apporté sur ce sujet - nous apprend à nous conformer aux postures attendues par les normes sociales.
Lorsque vous devenez tout à fait conscient·e de ces jeux de rôles, vous percevez la perte qu'ils engendrent et l'importance de les désamorcer. Cela vous conduira à accorder de l'importance à des voix et des personnes que vous sous-estimiez.
2. Le fonctionnement bureaucratique
Un aspect dominant de la culture industrielle est son idéalisation des process. Qu'une certaine division du travail puisse être profitable à l'ensemble de la société n'est pas une idée nouvelle. Déjà Platon la présentait dans sa République. Émile Dürkheim souligne aussi le renforcement du lien social par ce mode d'organisation du travail. Mais là où une certaine division du travail peut soutenir une cohésion organique de la société, l'hyperfragmentation des process produit quant à elle un fonctionnement bureaucratique défavorable à la vitalité du corps social.
Dans cette approche, il ne s'agit pas de coordonner différents métiers, mais de réduire au maximum la part de réflexion des agents. Les personnes doivent perdre le moins de temps possible à penser leurs gestes, que ce soit avant ou après les avoir effectués. Ces mêmes gestes sont pensés par d'autres qu'eux qui occupent un statut hiérarchique supérieur (voir point précédent) : chef·fe·s, expert·e·s, consultant·e·s, etc.
On a l'habitude de considérer l'optimisation du travail sous ce prisme, qui dissocie les petites mains des esprits qui les commandent. Cette approche bureaucratique peut bien favoriser la docilité, mais non la qualité du résultat à long terme.
Si l'on souhaitait plus d'engagement durable des personnes, moins d'épuisement, et si l'on souhaite accroître notre compréhension du travail qu'elles accomplissent, il faut solliciter leur implication intellectuelle au lieu de l'externaliser.
On doit à Hegel d'avoir mis en avant la fonction du travail pour l'humain : travailler n'est pas exécuter une tâche, mais manifester son esprit par son activité. En d'autres termes, le travail effectué laisse dans le monde l'empreinte qu'on a d'abord imaginée dans notre esprit. Avant même d'avoir besoin de reconnaissance par autrui, on a besoin de se reconnaître soi-même dans la façon dont on transforme de la matière. Et travailler, d'une façon ou d'une autre, c'est apporter des transformations dans le monde.
Le plaisir de faire des ricochets est du même ordre selon Hegel : il s'agit d'observer les effets dans le monde d'un geste qu'on a initié, d'abord mentalement. Marx, élève de Hegel, développera de près cette idée : là où l'araignée exécute ce que son instinct lui commande, l'humain accomplit ce qu'il imagine d'abord. Son travail matérialise son intelligence. Priver les personnes de cet aspect de leur travail en les réduisant à des rouages, c'est les déshumaniser ou, pour reprendre un terme de Marx, les aliéner.
Dans une organisation du travail respectueuse des êtres humains, les personnes sont les mieux placées pour penser ce qu'elles font : avant, pendant et après. C'est donc leur réflexion et leur parole qu'il faut solliciter.
3. La répression de l'intelligence individuelle au nom de l'intelligence collective
La coutume actuelle est d'encourager l'intelligence dans une entreprise par des ateliers dits d'intelligence collective. On a donc bien pris conscience que nos modes d'organisation verticale ne tiraient pas assez profit des idées des salarié·e·s. Mais on a pallié ce problème en le déplaçant : désormais, au nom de l'horizontalité, il faut endurer des heures d'ateliers formatés où les questions, les exercices, le lexique et les options à disposition sont configurés par des animateur·rices.
De la sorte, on continue d'empêcher ce qui pourtant conditionne l'exercice de l'intelligence : l'indépendance d'esprit et, par là, la possibilité individuelle de formuler des problèmes et des options de façon divergente, en interrogeant les présupposés de la question imposée.
La verticalité se poursuit donc. Les personnes qui pourraient apporter le plus par leur indépendance d'esprit sont celles qui souffrent davantage de ces dispositifs : d'une part, parce qu'elles sont conscientes de la perte intellectuelle et économique que cela représente, d'autre part parce qu'elles doivent s'auto-réprimer durant plusieurs heures pour s'adapter à la norme collective.
Si l'on peut évidemment identifier l'intérêt socialisant de certains espace-temps collectifs, ceux-ci supposent aussi souvent une forme de répression de l'intelligence. Les observations de Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules, prolongées plus tard par Freud, soulèvent des difficultés mais elles développent ce que nous avons pu observer à nos dépens : l'esprit de groupe favorise plus facilement le conformisme et l'irresponsabilité, que l'intelligence et l'autonomie.
Plus récemment, des travaux de psychologie sociale ont montré le rôle crucial exercé par celle ou celui qui, dans un groupe, élève le premier / la première une voix critique. Aussi longtemps qu'une voix divergente est tue, le groupe obéit aux normes, même injustes.
Pour solliciter et encourager l'intelligence des salarié·e·s, il faut donc les inviter individuellement à exprimer leurs pensées les plus singulières, en les libérant de diverses façons de l'influence du groupe. Ce sera là le meilleur moyen de les impliquer et d'apprendre d'elles.
4. Le souci d'occuper
Dans l'organisation traditionnelle du travail, une même peur est à la racine de nombreux dispositifs contre-productifs : la peur de payer à ne rien faire. Il faut donc contrôler non seulement le nombre d'heures, mais leur remplissage. Et de fil en aiguille, d'année en année, on ajoute des pratiques à d'autres pratiques sans questionner leur fonction. La « rationalisation » du travail signifie souvent une réduction des ressources, mais non une réduction des tâches. Parfois même, la réduction des emplois s'accompagnent d'un accroissement des tâches bureaucratiques. Cela n'est pas si contradictoire qu'il n'y paraît : la volonté de contrôler les personnes en les occupant conduit à augmenter les tâches inutiles.
Ce besoin d'occuper les salarié·e·s pour apaiser la peur des dirigeant·e·s est un inhibiteur d'intelligence majeur. Pourquoi ? Parce que notre psyche est ainsi faite qu'exécuter des tâches inutiles génère une insatisfaction qui peut devenir douloureuse à la longue. L'absurde est source d'insatisfaction. Pour se protéger au mieux de cette insatisfaction, les individus développent des défenses psychiques et se désintéressent de leur travail. Lorsqu'on doit faire quelque chose que l'on sait absurde, on se retire mentalement de l'action physiquement accomplie, et cela a un coût psychique.
Un moyen facile de contrecarrer cette pratique inhibitrice d'intelligence est de réduire les tâches sans supprimer les emplois. En éliminant intelligemment les tâches inutiles sans diminuer les ressources, on peut réduire le temps travaillé et augmenter les salaires. Un dispositif où chaque personne impliquée gagne à être intelligent·e gagne en vitalité et conserve ses ressources les plus précieuses : les personnes.
Ce 4ème point nous conduit donc au suivant...
5. La sous-valorisation salariale
Tout travail mérite salaire. Mais inconsciemment, le salaire annoncé ne détermine pas tant l'action que le degré d'implication intellectuelle que la personne y engagera. À bas prix, elle remplira le contrat de la façon la plus minimale. À prix élevé, elle y mettra tout son esprit et elle le fera d'autant plus facilement qu'elle éprouve de la satisfaction d'être économiquement reconnue. Incidemment, la survalorisation salariale (eu égard aux pratiques de sous-valorisation) est une manière judicieuse d'encourager les employé·e·s à accroître leur implication. A fortiori si l'on explicite qu'on fait appel à leur indépendance d'esprit.
On objectera qu'il n'y a qu'une façon de respecter un cahier des charges précis. Mais l'expérience prouve le contraire : le geste poursuivi jusqu'à sa fin avec le plus d'attention n'est pas semblable à sa version minimale. On peut jouer une partition de multiples façons et l'habileté même ne suffit pas à déterminer le geste : l'ardeur intellectuelle de la personne change tout.
D'une certaine façon, la vitalité d'une structure collective repose sur la capacité qu'y développent les personnes à penser et faire autre chose que ce qu'on attendait d'elles. Cela devrait définir au sens propre une culture d'entreprise, c'est-à-dire un patchwork original tissé par la libre intelligence de chacun·e.